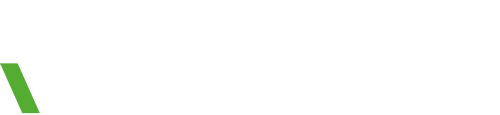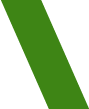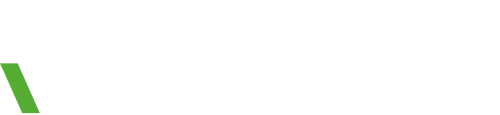Le reporting ESG occupe le devant de la scène depuis le début de l’année, avec l’entrée en vigueur de la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Celle-ci fixe de nouvelles normes et obligations de reporting extra-financier afin d’encourager le développement durable des entreprises notamment pour le volet environnemental et d’identifier celles qui sont disciplinées en la matière.
Si son application ne concerne que les grandes entreprises et les PME cotées en bourse, et sera déclinée en plusieurs étapes au cours des prochaines années, le renforcement de la réglementation pousse de nombreuses entreprises à implémenter stratégie et outils. Selon une étude d’Advaes, le marché des logiciels environnement, social et gouvernance (ESG) devrait croître de 26% par an en France entre 2024 et 2027.
PUBLICITÉ
De la collecte à l’exploitation des données ESG, un chemin semé d’embûches
En matière de reporting ESG, le cas d’usage le plus répandu actuellement chez les entreprises concerne les données des émissions de gaz à effet de serre (GHG), qui sont réparties en plusieurs scopes (1, 2 et 3). Lesdites données peuvent être internes à l’entreprise (consommation électrique, déplacements, factures diverses…) ou externes (comme les facteurs d’émissions provenant de bases de données telles que celle de l’Ademe).
Si la première étape consiste à réaliser un inventaire des données internes des scopes 1 et 2 qui regroupent respectivement les émissions directes ainsi que les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité, celles-ci sont présentes dans des documents à structure complexe et variée (factures, emails, documents numérisés…), dont la mise en commun peut être ardue. D’autre part, il est parfois difficile d’identifier les facteurs d’émissions appropriés. Par exemple, quelle quantité de gaz à effet de serre est émise par la consommation d’1 kWh ? D’autant que cette valeur va différer en fonction de la localisation. Une entreprise qui dispose de sites en France et en Allemagne devra donc identifier deux facteurs d’émissions spécifiques. A cela s’ajoute la dimension temporelle pour prendre en compte les variations de la production d’électricité renouvelable, et l’équation se complexifie encore considérablement.
C’est pourquoi, dans un premier temps, les entreprises optent souvent pour une saisie manuelle des facteurs d’émission. Toutefois, cette méthode est extrêmement chronophage : en plus de mener à des erreurs, elle atteint très rapidement ses limites dès qu’il faut se concentrer sur les émissions indirectes (scope 3).
Accélérer la prise de décision pour une véritable stratégie environnementale
En faisant le choix d’une plateforme analytique pour l’ESG, la capacité des entreprises à collecter, analyser et exploiter efficacement les données environnementales, sociales et de gouvernance est simplifiée.
Les facteurs d’émissions peuvent être intégrés de manière automatique, permettant d’identifier les principaux axes d’émissions de GHG d’une entreprise. Celle-ci sera ainsi mieux armée pour comprendre et concentrer ses efforts sur les postes où l’impact serait le plus significatif : est-ce l’empreinte numérique ? La consommation énergétique des bâtiments ? La flotte de véhicules ?
Une fois cette plateforme implémentée, il est alors plus aisé d’étendre progressivement le périmètre d’analyse aux émissions de scope 3, qui sont susceptibles de mettre en valeur l’impact réel de l’activité de l’entreprise sur les émissions GHG. En effet, toutes les entreprises sont liées et l’échange d’informations entre entreprises pourrait être facilité par de telles plateformes ESG. Ainsi une entreprise doit calculer ses émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 3), celles-ci correspondent aux émissions directes d’autres entreprises en amont ou en aval de la chaîne de valeur.
L’ajout de nouveaux indicateurs et leur niveau de détail peut ensuite être progressivement pris en compte. Car, si les cas d’usage se concentrent aujourd’hui essentiellement sur les émissions de GHG, il ne s’agit qu’une des neuf limites planétaires identifiées comme pouvant entraîner des conséquences dramatiques à l’échelle mondiale dès lors qu’une limite est atteinte. Les scientifiques estiment que 6 de ces limites ont déjà été dépassées : le changement des climats, l’érosion de la biodiversité, le cycle de l’eau douce, la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, l’introduction de nouvelles entités dans la biosphère et le changement d’usage des sols.
Par conséquent, en se concentrant uniquement sur le dérèglement climatique, le risque de ne pas traiter les questions environnementales de manière globale est élevé, ouvrant la porte à une certaine forme de greenwashing, même involontaire. Ces prochaines années, les entreprises vont donc devoir travailler avec des indicateurs qui vont au-delà des émissions de GHG, afin d’évaluer plus précisément le véritable impact environnemental de leurs activités.
En définitive, les cas d’usage liés à l’ESG vont bien au-delà des obligations de reporting. Pour établir leur stratégie de réduction d’impact environnemental, les entreprises ont besoin de mieux maîtriser leurs données, y déceler des informations cachées, réaliser des simulations avec des scénarios prédéfinis… Au-delà d’une réponse à un besoin crucial, c’est une opportunité d’anticiper les tendances, d’optimiser l’impact global et de se démarquer sur le marché. Toutefois, attention à la technologie choisie. Il serait ironique que la plateforme de données mise en place pour la stratégie ESG ait elle-même un impact environnemental non maîtrisé.