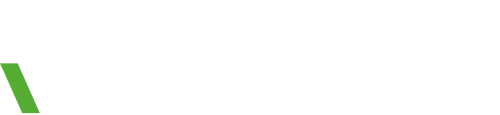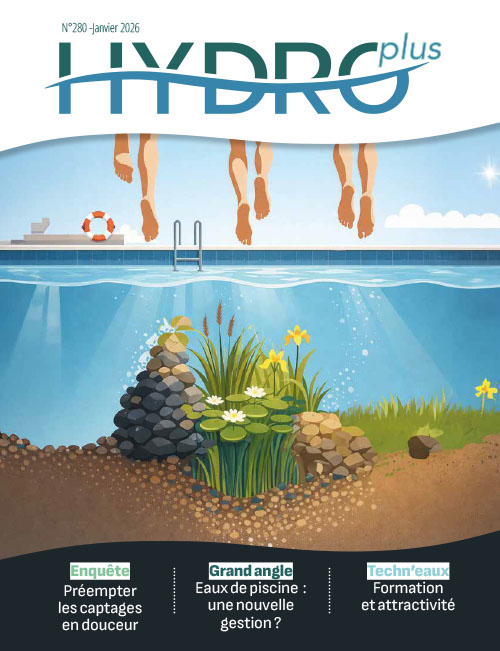Par petites touches, l’enquête publique est dévitalisée. La procédure concerne un nombre de plus en plus restreint de projets. Et les échanges entre les maîtres d’ouvrage et les citoyens, par la médiation du commissaire-enquêteur, se raréfient au profit de la consultation numérique. Une participation low-cost et à haut risque de régression démocratique.
Faire de l’exception la règle de demain ? C’est vraisemblablement le sort promis à l’enquête publique dématérialisée. D’abord circonscrite à des domaines précis (équipements liés aux Jeux olympiques, établissements pénitentiaires, contrôles aux frontières post-Brexit) ou à des territoires d’expérimentation (Bretagne et Hauts-de-France), la participation du public par voie électronique (PPVE) s’est étendue durant le confinement.
Faire de l'exception la règle de demain ?
Les chantiers des Jeux olympiques sont un cas particulier : l’Autorité environnementale évalue ces projets et la Commission nationale du débat public (CNDP) désigne des garants, force de proposition sur les modalités de la PPVE, dont ils rédigent la synthèse. Sur le projet de ZAC où s’élèvera l’Arena II, ces tiers indépendants ont obtenu de l’autorité organisatrice (ville de Paris) la tenue de réunions de lancement et de restitution et échangé avec les riverains lors d’une animation de rue.
« Du début à la fin de la procédure, le public a pu dialoguer avec les garants et le porteur du projet, questionné sur la prise en compte ou non des observations citoyennes et les raisons de ses décisions – ce que ne permet pas l’enquête publique », relève Sylvie Denis-Dintilhac. Pour son co-garant Jean-Louis Laure, « la procédure dématérialisée n’est pas un frein à la participation si elle est médiatisée, si l’on va au-devant du public et l’incite à s’exprimer sur Internet. On dispose d’une palette d’outils plus large que le commissaire-enquêteur pour créer les conditions d’un dialogue territorial ». Lequel reste toutefois suspendu au bon vouloir de l’autorité organisatrice : le préfet de Seine-Saint-Denis a écarté toute réunion publique sur le village olympique et paralympique.
« Enquête publique 2.0 »
Dans les autres cas de figure, « l’enquête publique 2.0 » n’a guère de partisans. Aucun porteur de projet n’a encore choisi de recourir à cette procédure allégée dans les régions où elle testée, de 2018 à 2021 (loi « Essoc » d’août 2018). La présidente de la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs (CNCE) conclut à un « véritable échec », dans un courrier adressé mi-février au Premier ministre. D’un département à l’autre, la pratique variera : enquête publique avec commissaire-enquêteur ou bascule vers la PPVE. Or « la loi, c’est une garantie pour tous ! Le libre choix laissé aux préfets (…) risque de porter atteinte à ce sacro-saint principe », poursuit Brigitte Chalopin.
Du côté du public, une large frange est exclue de fait de la PPVE : un Français sur quatre ne sait s’informer et un sur cinq ne sait communiquer par Internet, une faille plus marquée chez les personnes âgées et peu diplômées (Insee, octobre 2019). A cet illectronisme s’ajoutent les zones blanches où vivent 10,1 % de la population (UFC-Que choisir, mars 2019). Dans un communiqué commun publié fin avril, les présidentes de la CNCE et de la CNDP voient dans « la volonté de généraliser » la consultation numérique « un profond facteur de discrimination ».
« Un profond facteur de discrimination »
La PPVE sied toutefois aux salariés peu disponibles pour les permanences du commissaire-enquêteur, qui se forgent un avis à partir de données en ligne. « Le numérique affranchit des contraintes spatio-temporelles, c’est une voie complémentaire pour capter les remarques du public, observe Jean-Pierre Chaulet, vice-président de la CNCE. Mais le commissaire-enquêteur conserve un rôle crucial de décryptage de documents de plus en plus consistants et complexes. » Un commissaire-enquêteur soupèse à « 8 kg » le dossier d’enquête publique sur un projet éolien dans la Somme. Un collègue de Savoie évalue au « mètre cube » le volume des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) en zone de montagne.
La PPVE donne lieu à une synthèse du préfet, qui décide aussi de la poursuite du projet. « Dans le nouveau régime de participation low-cost, un acteur détient le monopole de la parole, pointe Cécile Blatrix, professeure de sciences politiques (AgroParisTech). Cela entretient la défiance vis-à-vis des institutions. » Exit donc le rapport du commissaire-enquêteur, tierce partie restituant les positions des intéressés et pouvant faire bouger les lignes. En grande couronne parisienne, un projet de PLUi a d’abord été rejeté par plus d’un tiers des communes. Pour être finalement adopté par 91 % des membres, après que « l’interco a levé les réserves émises par le commissaire-enquêteur et suivi ses recommandations, relate Jean-Pierre Chaulet. Ces communes vivront mieux ensemble ».
Vers des recours massifs ?
Rien ne garantit que la consultation électronique fera gagner du temps aux porteurs de projet. Comment instaurer un dialogue constructif sans les bons offices du commissaire-enquêteur, qui vérifie le dossier du maître d’ouvrage, le rend intelligible au grand public, conduit chaque acteur à étayer ses positions ? « La PPVE ouvre la voie aux recours massifs, ce qui placera le juge en régulateur des décisions publiques », anticipe Marie-Pascale Deleume, administratrice d’Eau et rivières de Bretagne. Florence Denis-Pasquier, vice-présidente de FNE, rappelle que la fédération « gagne trois contentieux sur quatre ».