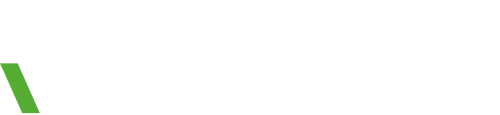Depuis le lundi 24 juillet 2017, des incendies ont dévasté plus de 4.000 hectares dans le Sud-Est de la France, sur le littoral méditerranéen et en Corse. Ces incendies attisés par des vents violents, ont engendré l’évacuation de plus de 10.000 personnes dans la nuit du mardi 25 juillet au mercredi 26 juillet dans le Var, et de nombreux départements du Sud restent en alerte. Depuis plusieurs années, le centre de l’Institut national de recherche et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea) d’Aix-en-Provence mène des recherches afin de comprendre les raisons de ces incendies et améliorer la gestion des risques qui y sont liés. « Le changement climatique et la modification des implantations humaines font peser de nouvelles menaces sur la végétation et les habitants des forêts méditerranéennes », remarquent les scientifiques de l’Irstea. Alors que 500.000 hectares de forêt sont en moyenne brûlés chaque année, et qu’une commune sur six est classée en risque en France, les chercheurs développent « des outils et méthodes pour l’ensemble des acteurs du territoire et anticipent les effets du changement global afin d’améliorer la résilience de la forêt. »
PUBLICITÉ
Dans une infographie détaillant les rôles de chacun en cas d’incendie, l’Irstea rappelle que les services départementaux d’incendies et de secours, l’État major interministériels, les maires, sont en première ligne de la gestion des crises. Les collectivités locales, avec l’appui des services de l’État, bénéficient quant à elles d’outils de prévention, notamment grâce à la Planification aménagement sur la prévention (PPRIF) ou la Préparation des populations à la crise (PCS). Une surveillance doit aussi être opérée par les Comités communaux de feux de forêt, l’Office national des forêts (ONF) ou les services de secours.
Selon l’Irstea, plusieurs outils et méthodes permettent de faciliter les prises de décision : établir une échelle d’intensité du phénomène feu, développer une cartographie des interfaces habitat-forêt, développer des logiciels de gestion des forêts après le feu ou encore une application smartphone afin d’alerter les populations. L’Irstea détaille également une méthode pour évaluer la vulnérabilité du bâti. « La vulnérabilité interne (caractéristiques du bâti : matériaux de construction, accès), l’exposition (l’environnement du bâti) et la capacité de réponse (le potentiel de réaction, facilité d’évacuation voire capacité d’auto-défense) », sont les trois composantes de cette évaluation. Elle peut donner lieu à « un modèle de vulnérabilité objectif, regroupant différents critères et testé sur plusieurs feux passés », explique l’Irstea. La modélisation et la cartographie des feux de forêts, selon un modèle de propagation, des données sur la végétation et les retours d’expériences, peuvent s’avèrent des outils efficaces selon les chercheurs.
Des impacts sur les écosystèmes
Pour panser les plaies causées par les incendies sur la biodiversité et les écosystèmes forestiers, l’Irstea Aix-en-Provence a développé la version française du logiciel Postfire-DSS. Il permet d’agir après le passage d’un incendie. « Les outils d’aide à la décision comme celui-ci - développés dans le cadre du projet de recherche européen FUME - expliquent comment obtenir des structures forestières moins inflammables, pour la plupart des peuplements, notamment des résineux dont la gestion est complexe, des peuplements forestiers plus résistants face au feu, et se régénérant mieux après le passage du feu. Nous avons, par exemple, montré comment transformer des peuplements de pins en forêt mélangée pin et chêne blanc pour limiter les risques à long terme », explique Thomas Curt, ingénieur-chercheur à Irstea. Les chercheurs soulignent notamment que le chêne liège et le pin d’Alep, deux espèces d’arbres pourtant résistantes aux incendies, « présentent des signes de dépérissement » dans le pourtour méditerranéen depuis 2013. En cause : la sécheresse et les feux de forêts annuels. D’après l’Irstea, il faut environ 50 ans pour qu’une forêt se régénère entièrement.