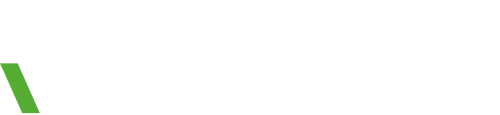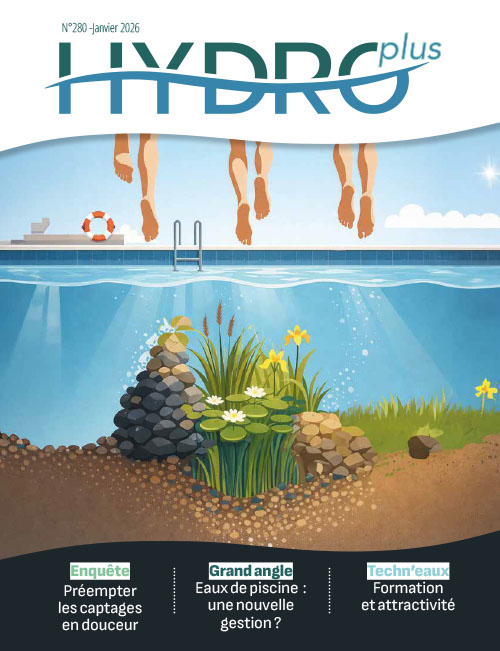Pourquoi l’atmosphère du Soleil atteint-elle des températures dépassant le million de degrés, alors que sa surface plafonne à 6000 °C ? C’est l’un des mystères fondamentaux de l’astrophysique solaire. Une avancée majeure dans sa compréhension vient d’être franchie par une équipe de chercheurs pilotée par Tahar Amari, directeur de recherche CNRS au Centre de physique théorique de l’École polytechnique (CPHT), qui démontre que des cordes magnétiques – jusqu’alors invisibles dans les zones dites « calmes » du Soleil – sont en réalité omniprésentes et énergétiquement actives.
PUBLICITÉ
Les chercheurs valident ainsi une prédiction formulée dès 2015 dans la revue Nature, où l’existence de telles structures avait été suggérée sur la base de simulations. Cette fois, les simulations sont accompagnées d’observations directes, renforçant la portée de la découverte.
Jusqu’à présent, ces cordes et cages magnétiques avaient été étudiées principalement dans les régions actives du Soleil, connues pour leurs éruptions spectaculaires. Ce nouveau travail montre qu’elles jouent également un rôle central dans le « Soleil calme », en alimentant des phénomènes discrets mais énergétiques comme les jets, spicules et « feux de camp » récemment observés par la mission Solar Orbiter.
« Nous avons démontré que ces cordes apparaissent à la même altitude que les feux de camp, et qu’elles contiennent l’énergie nécessaire pour les déclencher », explique Tahar Amari. « Mieux encore, elles se connectent à de vastes boucles magnétiques qui relaient cette énergie plus haut dans l’atmosphère, via des ondes d’Alfvén. » Ces microstructures seraient donc des vecteurs essentiels du transfert d’énergie entre la surface solaire et ses couches supérieures. Non seulement elles participent à des échauffements localisés, mais elles provoquent également de petites éruptions, contribuant de manière diffuse mais significative au chauffage coronal.
En rendant visible et mesurable l’omniprésence des cordes magnétiques dans l’ensemble du Soleil, cette étude propose une vision unifiée des mécanismes éruptifs. Qu’elles se situent dans des zones calmes ou actives, ces structures seraient le moteur commun du transport d’énergie à l’origine du comportement thermodynamique complexe de notre étoile. De nouvelles campagnes d’observation, menées notamment par Solar Orbiter et le télescope solaire américain DKIST, pourraient enrichir ces résultats en apportant des données encore plus précises sur les champs magnétiques solaires à toutes les échelles.