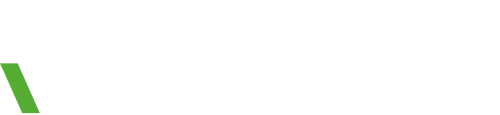Tant que l’on ne saura pas absorber les excédents d’électricité quand il y en a trop, et limiter la demande quand il n’y en a pas assez, les prix continueront à se comporter comme un électrocardiogramme instable, avec des conséquences concrètes sur les coûts de production, sur l’investissement dans les renouvelables, et in fine sur la facture des consommateurs.
PUBLICITÉ
Un potentiel de flexibilité sous-estimé
Souvent négligés dans les discussions sur le stockage ou la flexibilité, les chauffe-eau électriques constituent pourtant un levier considérable. En France, la production d’eau chaude sanitaire représente environ 15 % de la consommation énergétique des logements, et les chauffe-eau électriques sont présents dans près d’un tiers d’entre eux — soit environ 15 millions d’appareils. Tous sont déjà équipés de résistances capables de transformer l’électricité en chaleur, sans besoin d’infrastructures nouvelles.
Ce qu’on oublie, c’est que cette chaleur, on peut la décaler dans le temps. L’eau chaude n’a pas besoin d’être chauffée à heure fixe, elle peut l’être quelques heures plus tôt, ou plus tard, sans altérer le confort des usagers. Mieux : cette capacité de déplacement de la consommation permet précisément ce que le système électrique appelle aujourd’hui de ses vœux — une forme de stockage de courte durée, à l’échelle de quelques heures, parfaitement adaptée à l’intermittence solaire et éolienne.
Une flexibilité sans dégradation, sans surcoût, sans contrainte
Contrairement aux batteries, ces appareils n’ont aucune usure associée aux cycles de charge. Ils ne nécessitent aucune infrastructure nouvelle : ils sont déjà dans les logements. Et ils peuvent être pilotés de manière automatisée, silencieuse, sans action de l’utilisateur. L’eau chaude est toujours là quand on en a besoin. Mais l’électricité consommée pour la chauffer peut être synchronisée avec la production renouvelable excédentaire — ou suspendue lors des pics de tension.
La technologie de pilotage existe, elle est mature, et elle est déjà opérationnelle dans certains territoires. On peut donc agir maintenant, sans attendre un hypothétique déploiement massif de batteries stationnaires ou de compteurs ultra-connectés.
Réduire le prix marginal, stabiliser le système
Activer cette flexibilité invisible, c’est aussi répondre à un enjeu plus large : celui du prix marginal de l’électricité, aujourd’hui déterminé par les moments les plus tendus du réseau. En réduisant ces pics et ces creux, on évite aux producteurs de vendre à perte — ce qui finit par renchérir leurs coûts sur les périodes normales. Et l’on donne de l’air au système sans ajouter de nouvelles tensions sur les infrastructures.
Il est donc temps de repenser les priorités. Avant d’investir des milliards dans de nouveaux équipements lourds, commençons par exploiter les ressources déjà installées, disponibles, activables immédiatement. Les chauffe-eau n’ont pas besoin d’être réinventés. Ils ont juste besoin d’être pilotés intelligemment.
Dans un contexte où chaque kilowattheure renouvelable compte, ce serait un non-sens économique, écologique et stratégique de continuer à les laisser fonctionner sans logique de réseau. Le réseau électrique a besoin de flexibilité. Elle existe. Utilisons-la.













![[Tribune] Face à la volatilité des prix de l’électricité, utilisons nos chauffe-eau](/e-docs/00/02/55/59/tribune-face-volatilite-des-prix-electricite-utilisons-nos-chauffeeau_1000x564.jpg)