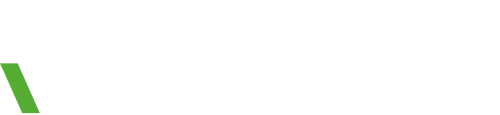Bridé durant la phase du « restez chez vous », le vélo s’avère une clé du déconfinement : il s’agit de dissuader d’un retour massif à la voiture, meilleure garante de distanciation physique que les transports publics – qui, de plus, tournent en sous-régime. Montpellier a posé les premiers séparateurs le 24 avril, affectant au vélo l’une des trois voies du pont enjambant le Lez et gommant ainsi une discontinuité cyclable. La Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne annoncent à eux deux une centaine de kilomètres de voies provisoires. Au total, une vingtaine de collectivités – souvent bien classées au baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB) – s’est positionnée et 120 ont suivi le récent webinaire du Cerema sur les aménagements cyclables temporaires.
PUBLICITÉ
De Berlin à Bogota en passant par Budapest
Selon une rapidité de décision et d’exécution qui tranche avec la complexité des procédures d’urbanisme. Chargé par la ministre de la Transition écologique et solidaire de coordonner les initiatives de terrain, le président du Club des villes et territoires cyclables, Pierre Serne, s’attache à lever les verrous. Pour autant, « le pouvoir de police du maire autorise déjà la réalisation rapide d’aménagements temporaires avec du banal matériel de signalisation, juge Thomas Jouannot, directeur de projet modes actifs au Cerema. Et l’affaissement du trafic automobile (3) permet d’user de l’outil classique du plan de circulation ».
La vélocité s’est d’abord exercée à l’étranger. Avec le confinement, Berlin (Allemagne) a pratiqué l’urbanisme agile au rythme d’« une semaine de réflexion, une de réalisation ». Lors d’un pic de pollution à la mi-mars 2019, Bogota (Colombie) a, d’un jour à l’autre, multiplié par cinq (à 117 km) le linéaire cyclable, stabilisé depuis à 35 kilomètres. Sa pérennisation est à l’étude. Expérimenter, évaluer, ajuster cadencent l’urbanisme pragmatique. Selon leur fréquentation, les axes issus de la crise sanitaire deviendront permanents, a annoncé Budapest (Hongrie) début avril. Thomas Jouannot prédit en France « un moment de vérité, que déterminera l’appropriation par les usagers » d’une offre renforcée. Équipements et services devront être accessibles.
Les projets s’accélèrent
Les projets déjà conçus s’accélèrent. Visant la pacification de 10 % du réseau viaire (soit 120 km), Oakland (Californie) déploie, à la faveur de l’épisode Covid, un programme défini en 2016. Sur des axes inscrits au schéma des mobilités actives de 2018, Montpellier crée 15 kilomètres de voies temporaires qui perdureront sûrement. Philippe Saurel, maire et président de la métropole, « souhaite, sur ces tronçons et sur ceux aménagés début mars en centre-ville, un retour progressif du trafic automobile, associé à ces nouvelles contraintes ». La pandémie hâtera l’avancement du Vélopolitain francilien, réseau de 9 lignes tracé par des associations et couvrant les axes majeurs du métro et RER, auquel la région annonce un soutien de 300 M€ (60 % du coût global). Pour sa présidente, Valérie Pécresse, l’effectif cycliste peut doubler (à 800 000/j) par beau temps.
L’État appuiera les collectivités, via le Fonds Vélo et les certificats d’économie d’énergie (CEE). Mais l’entrepreneur Marc Simonici l’a pris de vitesse en lançant un appel à projet (100 000 €/lauréat) fin avril. En Nouvelle-Zélande, l’État financera jusqu’à 90 % des chantiers locaux (appel à projet doté de 3,8 M€).
Sur le papier, le feu est vert pour les grands centres urbains. Avec une « remise en question des 2x2 voies, où pourrait s’insérer une piste cyclable bidirectionnelle », plaide Olivier Schneider, président de la FUB. Frédéric Héran recense en France une trentaine de précédents depuis 1995. Sans chaos : « Le trafic automobile ne justifie pas quatre voies », affirme l’urbaniste.
L’Etat appuiera les collectivités locales
Le tableau se ternit dans les villes moyennes, le périurbain et la ruralité. « La voiture est reine car les transports collectifs sont peu attractifs et les départements et l’État poursuivent l’extension routière, pointe Julien Dubois, président de l’association française pour le développement des véloroutes et voies vertes (AF3V). Les solutions pour franchir les infrastructures, qui font barrage aux cheminements piétons et cyclistes, seront plus coûteuses qu’en ville. » Pierre Serne note toutefois « des propositions de départements, quand l’État ne s’interdit pas des aménagements sur certaines nationales ». En centre-bourg, « la simple réduction de vitesse permet la cohabitation vélos-voitures », observe Élodie Trauchessec, animatrice mobilités actives à l’Ademe.
Partout, reprendre de la place à la voiture requiert une volonté politique. Et l’unanimité pour relier les voies cyclables sur des axes impliquant divers gestionnaires. Les forces de l’ordre – qui ont pu abusivement verbaliser des cyclistes durant le confinement – devront aider au respect du nouveau partage de l’espace public.
L’ampleur de la reprise du trafic automobile est la grande inconnue : les projections du Grand Lyon varient de – 30 % à + 20 % ! A Paris, absorber le report vers la voiture de seulement 5 % du trafic de la ligne 13 du métro nécessiterait quatre voies additionnelles à l’heure de pointe du matin. Impensable. La ville a démontré qu’un même axe draine plus de passagers à vélo qu’en voiture : sur le boulevard Sébastopol, le différentiel était de 20 % début mars, trois mois après l’ouverture de la piste à double sens, relève Charlotte Guth, cheffe de mission aménagements cyclables. « Et il y a encore de la capacité. »
(1). 25,3 % des salariés fin mars (ministère du Travail), contre 6 % d’ordinaire
(2). Baromètre FNH-Wemoov, janvier 2020
(3). Chiffré entre 60 et 90 % à la mi-avril par le Cerema