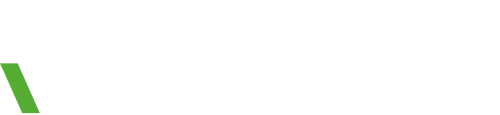C’est l’objectif du projet que la chambre régionale d’agriculture de Bretagne a conduit pendant quatre ans. Il a débouché sur la mise en place d’un réseau de fermes de référence pour analyser la variété des zones humides, mais aussi les pratiques agricoles associées. Un travail qui fait suite à un premier projet Interreg mené avec l’Angleterre sur le sujet entre 2009 et 2012.
PUBLICITÉ
Le projet a, en effet, été lancé dans un contexte local assez tendu, entre le dossier des algues vertes et l’inventaire des zones humides effectué dans le cadre des Sage. « Nous avons suivi 90 parcelles réparties dans 20 exploitations agricoles sur toute la Bretagne pour constituer un échantillon représentatif. Les agriculteurs ont mis à disposition leurs données et exposé leurs pratiques », détaille Marie-Hélène Philippe. La première étape de ce projet ambitieux a consisté à mettre au point un questionnaire d’enquête adapté. Des relevés sur la flore, les orthoptères (criquets et sauterelles) et les pratiques agricoles ont été réalisés. Le CBNB a ainsi participé à l’identification de neuf types de prairies. « En moyenne, nous avons dénombré une cinquantaine d’espèces sur les parcelles, preuve d’une assez bonne diversité », ajoute Marion Hardegen. Le CBNB et le Gretia ont ensuite rédigé des fiches descriptives par typologie de zones humides qui ont été croisées avec les pratiques agricoles afin de préconiser des modes de gestion. « La flore spontanée renseigne sur des éléments peu visibles, comme les propriétés du sol. Cela peut constituer une clé de compréhension pour les agriculteurs », ajoute la déléguée régionale du CBNB. Parfois, certains enjeux se rejoignent, à l’instar de la présence abondante de jonc diffus, inintéressant pour l’agriculteur, car il n’est pas mangé par le bétail, mais aussi du point de vue de la diversité. Favorisé par un pâturage trop précoce qui tasse le sol, son développement pourrait être limité en modifiant ces pratiques.
De son côté, l’Inra a étudié à la fois l’impact des pratiques agricoles sur la qualité de l’eau mais également les coûts de gestion au regard des services environnementaux rendus par ces zones humides afin de réfléchir à la notion de rémunération des agriculteurs pour les maintenir. Le guide méthodologique en cours de rédaction s’adressera aux agriculteurs ainsi qu’aux animateurs de Sage. Il contiendra des préconisations de pratiques tenant compte des contraintes agricoles.
Financé par l’agence de l’eau, la Région ainsi que les conseils départementaux bretons, le projet aura coûté 590 000 euros. Il a le mérite d’avoir engagé une collaboration entre le monde agricole et des acteurs régionaux de la biodiversité. D’autres projets sont envisagés, comme la mise en place d’un réseau régional de fermes de référence sur l’ensemble des enjeux de biodiversité.