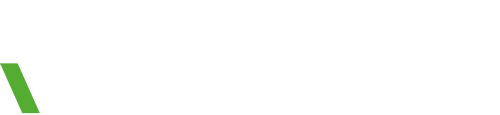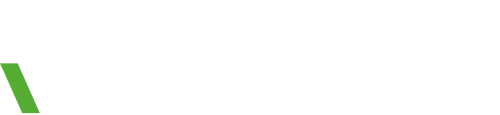Le cœur du système : une centrale géothermale qui puise l’énergie à 1 700 mètres sous terre, dans la nappe du Dogger. Grâce à des pompes à chaleur, l’eau naturellement chaude (60°C) est utilisée pour produire 77 000 MWh de chaleur par an, dont 55 000 issus de sources renouvelables. Une chaufferie au gaz complète le dispositif en appoint. À terme, ce réseau alimentera 11 500 équivalents-logements via 18 km de canalisations et quelque 70 sous-stations.
PUBLICITÉ
Ce projet s’inscrit dans une trajectoire plus large de transition énergétique initiée par le SMIREC il y a plus de 15 ans. En diversifiant les sources de chaleur — géothermie, biomasse — le syndicat a déjà fait passer la part d’énergies renouvelables dans son mix énergétique de 2 % à 65 %. Il vise désormais 75 % d’ici 2050.
« Le développement des réseaux de chauffage urbain est un choix politique fort, qui combine efficacité environnementale et justice sociale », affirme Laurent Monnet, président du SMIREC. Une position assumée face à l’urgence climatique, alors que les réseaux de chaleur deviennent un levier essentiel pour verdir les villes tout en garantissant un service public accessible.