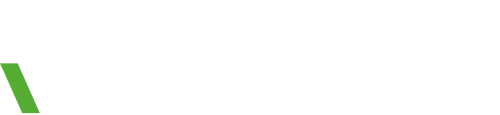La pollution de l’air est responsable dans l’Hexagone de 48.000 décès prématurés par an et son coût annuel est estimé entre 70 à 100 milliards d’euros. Agir contre cette pollution représente donc non seulement un fort enjeu sanitaire mais également un enjeu financier. En outre, certains polluants atmosphériques locaux cumulant un effet de serre puissant, les démarches antipollution sont à la fois bénéfiques pour le climat et la transition énergétique.
PUBLICITÉ
En France et en Europe, si la qualité de l’air s’améliore globalement, les dépassements de normes se concentrent principalement sur trois polluants : le dioxyde d’azote (NO2), les PM10 et l’ozone (O3). Cependant, dans un climat européen tendu par le « Dieselgate », Bruxelles a décidé de sévir. La France, qui a déjà reçu deux avis motivés, sur les PM10 et sur le NO2, a été renvoyée en mai dernier, avec neuf autres États, devant la Cour de justice européenne, ouvrant un contentieux sur le NO2. Un contentieux national concerne aussi quatorze zones en dépassement qui ont fait l’objet de feuilles de route présentées en avril dernier par le gouvernement à la demande du Conseil d’État. « La France a répondu aux injonctions de Bruxelles en lui exposant son plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prepa) adopté en mai 2017, ainsi que les feuilles de route. Or, tout ça manque d’ambition. Le Prepa ne contient que des mesures sectorielles indicatives et les feuilles de route sont très inégales. Certaines ne vont pas plus loin que les objectifs des plans de protection de l’atmosphère (PPA) », regrette Charlotte Lepitre, coordinatrice du réseau santé environnement chez France Nature Environnement.
Élaborés par les préfets dans les agglomérations de plus de 250.000 habitants et dans les zones à dépassement, 36 PPA couvrent à ce jour la moitié de la population française. « Ces PPA partent d’une démarche positive, mais l’État n’a pas assez de moyens financiers pour en accompagner les actions. Celles-ci dépendent plutôt des compétences des collectivités territoriales alors que la gouvernance est assurée par le préfet. Enfin, il manque une évaluation coût-bénéfice pour justifier les actions et favoriser leur appropriation », juge Marie-Blanche Personnaz, directrice d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes, qui en tant qu’Aasqa réalise les diagnostics et l’évaluation des plans liés à la qualité de l’air comme les PPA et les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Ces PCAET, issus de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, devaient être bouclés avant la fin de 2016 pour les EPCI de plus de 50 000 habitants et d’ici à la fin de cette année pour ceux de plus de 20 000 habitants. D’après le ministère de l’Écologie, à la mi-2018, seule la moitié des collectivités visées s’étaient engagées dans la démarche. En revanche, 20 % des plus petites ont lancé un plan volontaire. « La vertu des PCAET est d’agir conjointement sur la qualité de l’air et sur l’énergie, au plus près des territoires, sachant que les leviers d’action sont en partie communs, qu’il s’agisse de choix de mobilité ou de scénarios énergétiques », poursuit Marie-Blanche Personnaz.
En marge des outils réglementaires, l’Ademe soutient par ailleurs les initiatives locales en faveur de la qualité de l’air via ses appels à projets. « Par exemple, l’appel à projets Aact-air incite les collectivités à développer des actions innovantes en vue de favoriser les mobilités actives, comme le plan marche de Plaine commune », illustre Nadia Herbelot. Son Fonds air, lancé en 2015 sur la vallée de l’Arve pour financer le remplacement des chauffages au bois polluants, a depuis été étendu à treize territoires. L’agence a également noué une coopération récente avec Santé publique France pour l’appel à manifestation d’intérêt AirQPlus. Onze collectivités testent cet outil qui estime le bénéfice sanitaire de la baisse de pollution.
« Reste un levier à actionner pour lutter contre la pollution, souligne Marie-Blanche Personnaz, la communication en direction des citoyens, qui permet de faire passer des mesures “à priori” impopulaires si elles sont incomprises. » Notamment dans le domaine des transports, qu’il s’agisse de la modernisation du parc, en éliminant les véhicules diesel les plus anciens, ou de la mise en œuvre de zones à circulation réduite (ZCR), dispositifs qui visent à interdire l’accès aux véhicules les plus polluants, désignés par le certificat de qualité de l’air Crit’air. Pour les soutenir, l’État a entre autres instauré récemment une prime à la conversion des véhicules Diesel et il a introduit dans son appel à projets « Villes respirables en 5 ans » l’étude de ZCR. Aujourd’hui, seule une poignée de collectivités, Paris et Grenoble en tête, rejointes par Strasbourg et bientôt Lyon, l’ont mis en œuvre. Ce dispositif, déjà préconisé dans les PPA, pourrait cependant être étendu aux agglomérations de plus de 100 000 habitants par le projet de loi sur la mobilité.
Cet article est l’introduction du dossier "Pollution de l’air : une stratégie nationale en quête d’un nouveau souffle".
A venir :
- La première partie : "La Carene laisse entrer l’air dans ses plans", publiée le mercredi 7 novembre.
- La deuxième partie : "L’Eurométropole de Strasbourg mise sur la transversalité ", publiée le jeudi 8 novembre.
- La troisième partie : "Grenoble-Alpes Métropole avance en pionnière", publiée le vendredi 9 novembre.












![[Dossier] Pollution de l'air : une stratégie nationale en quête d’un nouveau souffle](/e-docs/00/01/DA/9E/dossier-pollution-air-une-strategie-nationale-quete-nouveau-souffle_620x350.jpg)