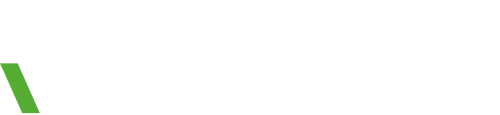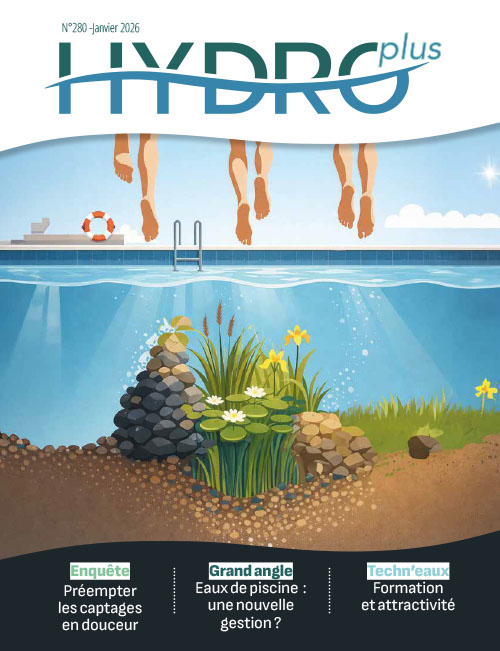Les expositions alimentaires aux pesticides sont de mieux en mieux connues, mais pas la contamination de l’air ni les risques associés d’inhalation ou d’exposition cutanée. En juin 2018, une campagne nationale pour mesurer 75 substances (produits phytopharmaceutiques, biocides, médicaments vétérinaires et antiparasitaires à usage humain) a été lancée par l’agence sanitaire Anses, l’Ineris (Institut national de l’environnement industriel et des risques) et Atmo France (qui fédère les associations de surveillance de la qualité de l’air AASQA).
PUBLICITÉ
Le lindane retrouvé dans 80% des échantillons
D’où la nécessité de creuser pour 32 « substances d’intérêt », identifiées en croisant la fréquence à laquelle elles ont été retrouvées avec les données de toxicologie de chacune d’entre elles. Elle feront l’objet d’évaluations approfondies. A commencer par le lindane, classé cancérogène et reprotoxique (toxique pour la fertilité et le développement de l’embryon). Pourtant interdit en France dans l’agriculture depuis 1998, ce produit probablement revaporisé dans l’air depuis le sol où il persiste, est celui qui a été retrouvé le plus souvent, dans près de 80% des échantillons.
« Il s’agira dans un premier temps d’identifier les motifs de persistance, puis de pouvoir estimer les expositions cumulées par les différentes voies (respiratoire, alimentaire, cutanée) et milieux d’expositions (air extérieur et air intérieur) », indique l’Anses.
Vers une surveillance pérenne
Le controversé glyphosate, qui avait jusqu’ici peu été mesuré dans l’air, intègre ce top 32. Il a été retrouvé dans environ la moitié des échantillons analysés mais nécessitant un appareil de mesure dédié, il n’a été recherche que sur huit sites, les plus exposés. « Les concentrations mesurées sont suffisamment faibles pour que nous n’ayons pas identifié d’alerte à ce stade », selon Ohri Yamada. Le chlordécone, pesticide utilisé jusqu’en 1993 qui a contaminé les sols de Guadeloupe et de Martinique pendant des décennies, n’a en revanche été détecté dans aucun prélèvement, y compris aux Antilles.
L’objectif est désormais d’instaurer une surveillance pérenne de certaines substances, voire que quelques unes rejoignent la liste des polluants réglementés. Aujourd’hui, une douzaine de polluants de l’air font l’objet d’une surveillance obligatoire par les AASQA (particules fines, dioxyde d’azote, ozone, métaux lourds....) et l’Anses a recommandé en 2018 d’en ajouter plusieurs (1,3-butadiène, particules ultrafines, carbone, suie...).
Atmo-France et les AASQA, qui font depuis plusieurs années des mesures ponctuelles de pesticides, ont plaidé ce jeudi pour une « surveillance nationale règlementaire » en la matière. Et appelé à une « multiplication des sites de mesures pérennes » pour améliorer l’information.
Lors de cette campagne, les 50 sites choisis intégraient différents profils de zones d’habitation (urbaines, péri-urbaines et rurales) et de productions agricoles (grandes cultures, vignes, vergers, maraichage, élevage). Conclusion : certaines substances sont majoritairement associées à certains profils agricoles, comme le prosulfocarbe aux grandes cultures ou le folpel à la viticulture, selon l’Ineris. Mais les stations de mesure n’étaient pas à proximité directe des zones d’utilisation des pesticides. Une autre étude, PestiRiv (Anses/Santé Publique France), doit examiner l’exposition des riverains immédiats, en commençant en 2021 par les zones viticoles.