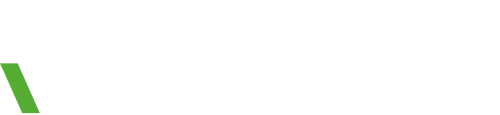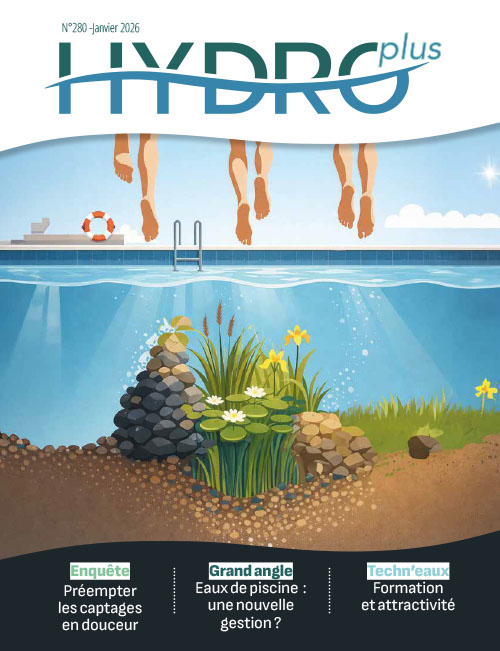La question de la décentralisation et du rôle des territoires dans la transition énergétique, au premier rang desquels les régions, est plus que jamais primordiale. Articuler les objectifs régionaux et nationaux - fixés par la PPE - et in fine, européens, fait sens d’un point de vue théorique : les engagements pris au niveau national devraient en effet être distribués en fonction des ressources et moyens des territoires. Par ailleurs, l’État joue un rôle d’accélérateur de la transition énergétique, en attribuant des moyens techniques, financiers et humains.
PUBLICITÉ
Les régions veulent trouver la meilleure façon de défendre leur autonomie institutionnelle tout en prônant des objectifs ambitieux. A l’heure actuelle, la somme des objectifs régionaux à horizon 2023 et 2028 dépasse les engagements nationaux : ils sont en fait cohérents avec les engagements pris par la France en termes de baisse des émissions de CO2 au niveau européen.
Un modèle énergétique au cœur des territoires
Les régions, en concertation avec les communes et intercommunalités, ont plus que jamais un rôle majeur à jouer pour fixer les caps, apporter sa connaissance des territoires, coordonner le développement économique territorial, et accompagner les filières et leurs structurations.
Décentraliser le développement et la gestion des EnR va dans le sens d’une certaine vision de la transition énergétique : celle d’un modèle énergétique au cœur des territoires, au plus près des citoyens dans une logique de circuit-court de l’énergie, participant à l’émergence d’une énergie 100% renouvelable. Cette vision est par ailleurs cohérente avec la nature même des énergies renouvelables, flexibles et décentralisées par nature.
Les acteurs du secteur des énergies renouvelables (notamment les gestionnaires et fournisseurs d’énergie verte), doivent, à travers la décentralisation, inciter l’émergence de projets plus proches du territoire, à taille humaine et dans le respect de l’environnement.
Des outils pour améliorer le développement local
Si l’État conserve de nombreuses prérogatives en matière d’énergie, les collectivités disposent de plusieurs outils pour favoriser et organiser le développement local des EnR.
Les « Appel à Initiatives Locales » portés au niveau régional sont ainsi des propositions concrètes pour accélérer la transition énergétique de nos territoires en accompagnant tous les acteurs locaux dont les collectivités, et leur permettant de s’approprier progressivement la gestion de l’énergie.
Indépendamment de leur éventuel engagement financier, les collectivités ont surtout la capacité à lever l’un des freins majeurs au développement des EnR : l’acceptabilité. Elles peuvent promouvoir le développement concerté d’infrastructures à taille humaine, en concertation avec les habitants, respectueuses des paysages et de la biodiversité, et créatrices de valeur aux bénéfices directs pour les citoyens. On pense notamment à la possibilité pour les riverains d’une installation de production d’énergie renouvelable de bénéficier d’une offre de fourniture d’énergie locale et compétitive.
Pour autant, les collectivités n’ont pas vocation à être des gestionnaires d’énergie. Elles sont avant tout des cheffes d’orchestre qui mettent en mouvement et organisent le développement local des EnR en impliquant citoyens et acteurs économiques locaux. Elles apportent une vision stratégique, une connaissance du contexte local, éventuellement des terrains et des toitures et, le cas échéant, une capacité d’investissement de long terme stabilisatrice.
C’est un rôle primordial dans la réussite de la transition énergétique. Mais, pour le reste, elles ont tout intérêt à se faire accompagner et à s’appuyer sur des partenaires spécialisés, qui apporteront leur savoir-faire dans la définition, le déploiement et l’exploitation des actifs EnR, leur parfaite intégration dans les territoires et dans la gestion de l’énergie produite, intégrant les innovations au fil de l’eau comme la convergence avec le digital.












![[Tribune] La décentralisation, un prérequis pour contribuer à l’émergence d’une énergie 100% renouvelable](/e-docs/00/02/0C/51/tribune-decentralisation-prerequis-pour-contribuer-emergence-une-energie-100-renouvelable_620x350.jpg)